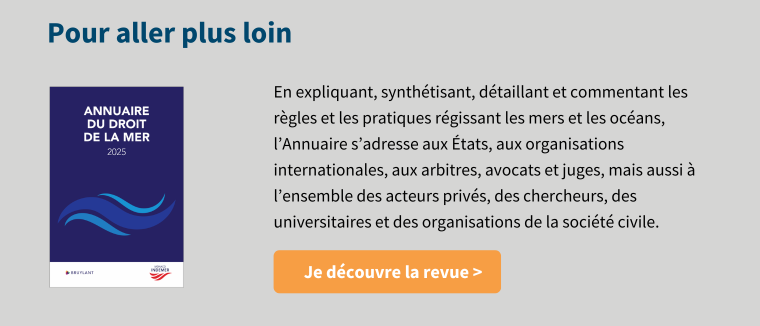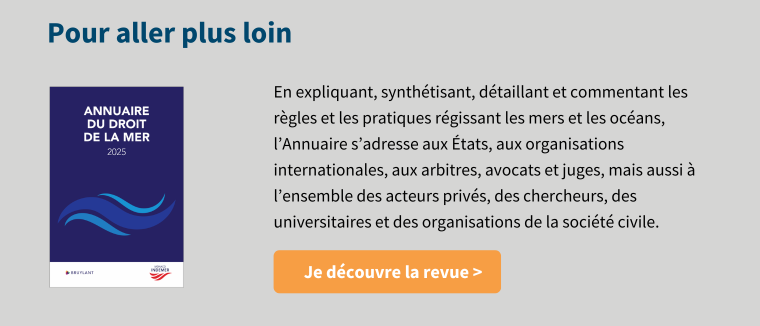Annuaire du droit de la mer
Entretien avec Kiara Neri
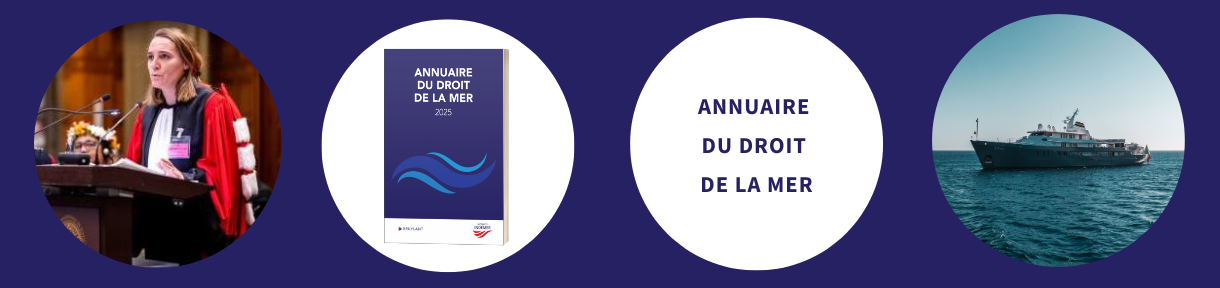
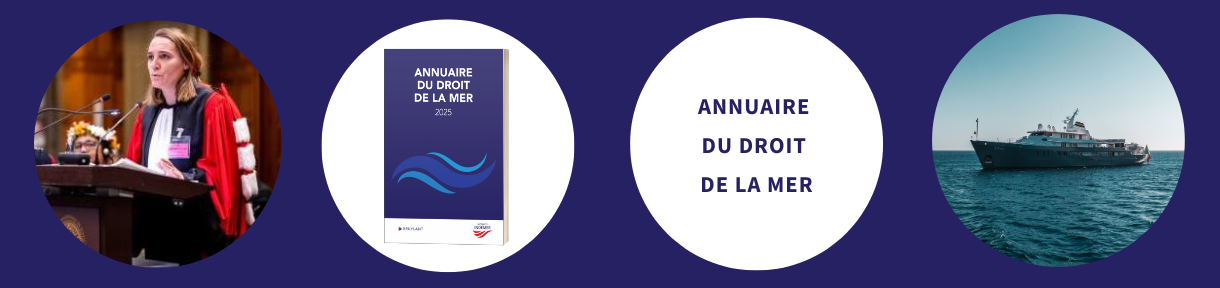
Entretien avec Kiara Neri, professeure de droit international, directrice du centre de droit international de l'Université Jean Moulin Lyon 3, à propos de sa récente chronique « Pratique de l’Union européenne » dans l’Annuaire du droit de la mer 2025 disponible dans son intégralité en Open Access sur Strada lex Europe.
L’Union européenne affiche aujourd’hui une ambition forte de « chef de file au niveau mondial » dans la gouvernance des océans en matière environnementale, commerciale et sécuritaire. Cette ambition ressort-elle de votre chronique dans l’Annuaire du droit de la mer 2025 ?
Tout à fait. Cette ambition s’y retrouve clairement. Toutefois, l’Union est parfois entravée dans son action par la répartition des compétences avec les États membres pour les questions maritimes, tantôt dotée d’une compétence exclusive (politique commune de la pêche), mais le plus souvent dotée d’une compétence partagée (conservation ; énergie ; migration) voire de pas de compétence du tout (défense ; délimitation maritime). Parmi toutes les actions, politiques et instruments de l’Union qui ont jalonnés la période (adoption du green deal, de l’accord BBNJ, de mesures de lutte contre les pollutions, la décarbonation du transport maritime, la protection de la vie humaine en mer face aux accidents et aux drames humains liés à la migration ou encore aux répercussions maritimes du contexte géopolitique et des tensions et conflits armés aux portes de l’Europe), il n’était pas possible de tout traiter en détail, la chronique se concentrant sur les domaines dans lesquels il y a une évolution des règles juridiques du droit de l’Union (sécurité maritime, énergie, climat, biodiversité et police et de défense -Chapitre 1) et sur la jurisprudence maritime marquante de la Cour de justice (Chapitre 2).
Une action maritime particulière de l’Union en matière de climat s’est-elle manifestée durant cette période et, si oui, de quelle manière ?
Soucieuse d’afficher une posture de « bonne élève » en matière climatique, l’Union continue d’investir le champ de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique en général et sur les océans en particulier. Pour atteindre ses objectifs climatiques énoncés dans la Communication de la Commission de 2021 Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, certaines mesures maritimes ont été développées par l’UE entre 2020 et 2024. Elles concernent principalement les énergies marines renouvelables et la décarbonation du transport maritime.
Quelle forme a pris l’action maritime de l’Union en matière de sécurité durant cette même période ?
Les années 2020-2024 ont été marquées par une grande activité de l’Union européenne en matière de police et de défense en mer. Ce dynamisme est évidemment lié au contexte international pour le moins tendu : aggravation des trafics maritimes (armes, drogue, migrants), mais également guerre en Ukraine, tensions en Méditerranée orientale ou encore attaques des Houthis depuis le Yémen. C’est principalement en matière de surveillance des frontières extérieures (FRONTEX) et dans le cadre des opérations maritimes EUNAVFOR que l’Union a agi sur cette période. Les opérations EUNAVFOR relèvent de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’UE, et permettent à l’UE de recourir à des moyens civils et militaires « pour le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale » en dehors du territoire des États membres (art. 42 du TUE). L’opération historique Atalanta a été profondément modifiée, tandis que l’Union a mis fin à l’opération Sophia et créé deux nouvelles opérations : Irini et Aspides.
Quelle a été l’apport de la Cour de justice de l’Union européenne ?
Les affaires Sea Watch jugées par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 1er août 2022 contribuent à clarifier les obligations et compétences de l’État du port à l’égard des navires destinés à des activités de recherche et de sauvetage en mer. Ces affaires, qui s’inscrivent dans un contexte tendu entre les organisations non gouvernementales (ONG) qui pratiquent le sauvetage en mer et les autorités italiennes, révèlent l’exploitation par les autorités italiennes de l’absence en droit de l’Union ou en droit italien, de dispositions et/ou de classification régissant l’activité de recherche et de sauvetage en tant que telle. Par conséquent, il existe systématiquement une distorsion entre la certification de ces navires par leur État du pavillon et leur utilisation réelle. Les autorités italiennes utilisaient alors cet écart pour inspecter et immobiliser les navires des ONG. Les renvois préjudiciels introduits par le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia portent sur l’interprétation de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port, ainsi que de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).
La Cour précise que le fait que des personnes se trouvent à bord d’un navire par raison de force majeure ou à la suite de la mise en œuvre de l’obligation d’assistance ne doit pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de vérifier l’application à ce navire d’une prescription quelconque de la convention SOLAS. Elle affirme avec force que « l’utilisation de navires de charge aux fins d’une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes se trouvant en situation de péril ou de détresse en mer ne peut pas être considérée, au seul motif qu’elle conduit ces navires à transporter un nombre de personnes sans commune mesure avec leurs capacités telles qu’elles résultent de leur classification et de leur certification, et indépendamment de toute autre circonstance, comme un facteur imprévu au sens dudit tiret, permettant à l’État du port de procéder à une inspection supplémentaire.