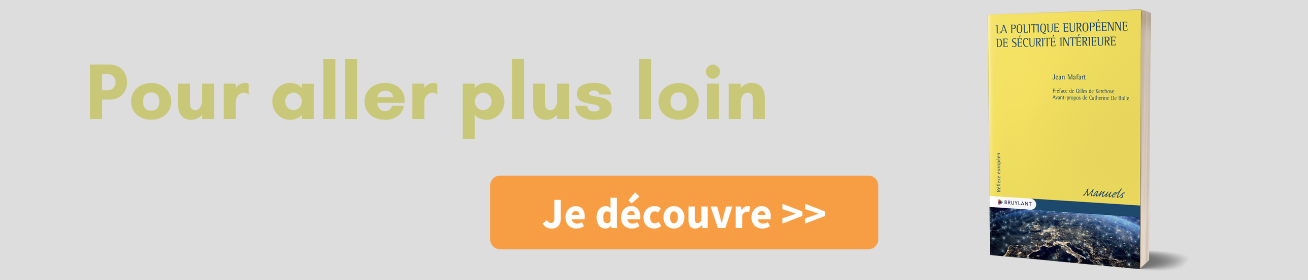La politique européenne de sécurité intérieure
Entretien avec Jean Mafart


Peu de citoyens européens le savent : l’Union européenne joue aujourd’hui un rôle considérable en matière de sécurité intérieure, qu’il s’agisse de ses agences, de ses systèmes d’information, de la coopération policière, de l’harmonisation du droit pénal entre États membres ou encore de la protection de leur frontière extérieure commune. Il était temps qu’un ouvrage de référence présente la politique européenne de sécurité intérieure. Nous avons rencontré son auteur.
Qu’est-ce qui vous a amené à entreprendre cet ouvrage ?
J’ai été très surpris de découvrir qu’aucun ouvrage ne présentait la politique européenne de sécurité intérieure alors qu’elle est devenue une des principales politiques de l’Union et qu’elle affecte directement nos vies quotidiennes. Elle continue d’ailleurs de se développer mais reste très méconnue, sans doute parce que nous continuons à associer spontanément les questions de sécurité à l’échelon national ou local.
Je me suis dit que, par mon expérience des questions de sécurité dans l’administration française et dans la sphère européenne, j’étais bien placé pour tenter de combler cette lacune. Je dois remercier deux personnes pour leurs encouragements : Gilles de Kerchove, ancien coordonnateur de l’UE pour la lutte contre le terrorisme, et Catherine De Bolle, directrice exécutive de l’agence Europol. Ils ont tous les deux contribué à l’ouvrage par une préface et un avant-propos remarquables.
A quel type de public cet ouvrage est-il destiné ?
Je pensais d’abord écrire un ouvrage assez général et assez court, puis je me suis pris au jeu et j’ai finalement livré un ouvrage plus complet. Il pourrait l’être encore davantage mais je souhaitais qu’il puisse toucher un public assez large : des étudiants, des enseignants, des praticiens des questions de sécurité dans les administrations, des fonctionnaires européens ou même des citoyens intéressés par le sujet.
J’ai évité la pure description et j’essaie de ne pas être trop technique : je souhaitais aussi proposer des analyses et des éléments de réflexion, par exemple sur les relations entre l’Union et ses Etats membres ou sur les nouveaux enjeux de sécurité.
Justement, comment évolue selon vous cette grande politique européenne ?
Je pense que l’« Europe de la sécurité intérieure » est entrée dans une phase décisive. Au départ, il s’agissait avant tout de compenser les effets de la libre circulation entre les Etats. Dans les faits, il y a des domaines où l’on est allé beaucoup plus loin que cela mais il y en a d’autres, au contraire, où la politique de sécurité a pris du retard sur la libre circulation.
Cela crée des fragilités qu’il faut impérativement corriger, d’où les efforts actuels pour renforcer le contrôle la frontière extérieure ou développer les échanges d’informations entre police européennes. Parallèlement, nous faisons face à des tensions géopolitiques qui obligent la politique de sécurité intérieure à évoluer pour mieux prendre en compte ce qu’on appelle les « menaces hybrides ».
Autrement dit, il faut continuer à renforcer la politique européenne de sécurité dans ses aspects traditionnels, comme le terrorisme, la criminalité organisée ou la frontière extérieure, tout en combattant plus efficacement les attaques informatiques, le sabotage ou la manipulation des processus électoraux. Tout ceci en coopération étroite entre l’Union et les Etats membres.
Vous évoquez assez longuement l’ordre juridique européen et le rôle des juridictions européennes : la politique de sécurité, ce ne sont donc pas que des coopérations opérationnelles ?
Non, loin de là : l’ordre juridique européen est un autre élément essentiel. Par exemple, il protège les droits fondamentaux et encadre donc assez strictement l’action des Etats et de leurs forces de sécurité. Il ne s’agit pas seulement de valeurs communes : c’est aussi une condition du bon fonctionnement de la politique de sécurité. Par exemple, comment appliquer un mandat d’arrêt européen si l’Etat membre qui demande à un autre Etat de lui remettre un suspect prend des libertés avec les droits fondamentaux ? Ensuite, cet ordre juridique a des conséquences très lourdes sur la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres ; cela peut d’ailleurs créer de réelles tensions.
Vous présentez aussi les acteurs de la politique de sécurité. Qu’avez-vous retenu de vos quatre ans à Bruxelles, à la représentation française auprès de l’UE ?
J’ai eu un grand plaisir à travailler avec les institutions européennes, les agences et mes collègues des autres Etats membres. C’est un environnement qu’on peut trouver parfois un peu trop bureaucratique mais qui laisse aussi beaucoup de place à l’initiative, aux échanges spontanés, à la créativité. L’Union européenne vaut bien mieux que l’image qu’en ont certains de nos concitoyens !