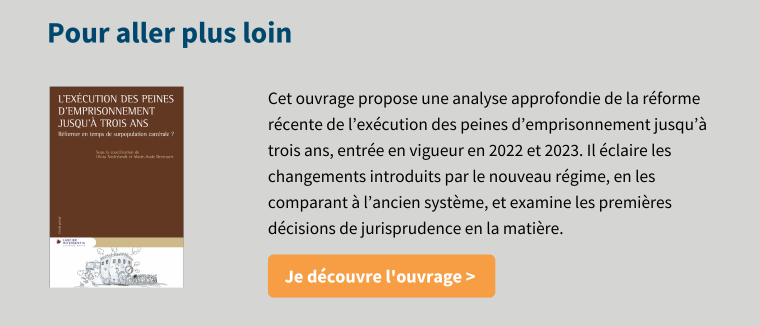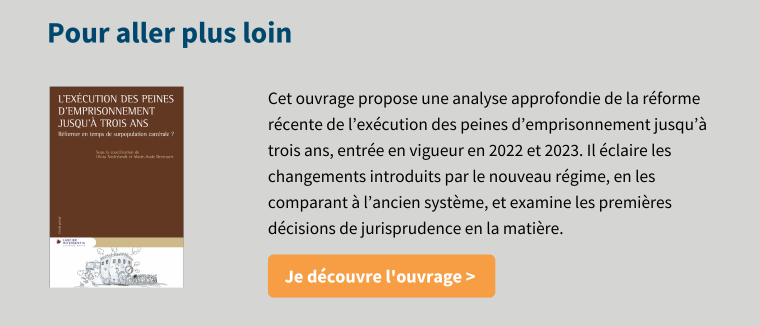L’exécution des peines d'emprisonnement jusqu'à trois ans
Entretien avec Olivia Nederlandt et Marie-Aude Beernaert


L’ouvrage propose une analyse approfondie de la réforme récente de l’exécution des peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans, entrée en vigueur en 2022 et 2023. Il éclaire les changements introduits par le nouveau régime, en les comparant à l’ancien système, et examine les premières décisions de jurisprudence en la matière. Nous avons rencontré les autrices de l’ouvrage.
Quelle est la réforme de l’exécution des peines jusqu’à trois ans d’emprisonnement dont il est question dans cet ouvrage ?
La réforme, entrée en vigueur en deux temps (2022 et 2023), concerne la loi SJE du 17 mai 2006. Elle transfère certaines compétences du pouvoir exécutif vers le juge de l’application des peines (JAP), spécifiquement pour les peines d’emprisonnement de six mois à trois ans. Ce changement visait à renforcer le rôle du JAP dans l’exécution de ces peines. Avant la réforme, celle-ci était régie par des circulaires administratives et passait souvent par une surveillance électronique suivie d’une libération provisoire, sans incarcération. Avec la nouvelle loi, l’exécution de chaque peine commence par l’incarcération effective, à moins d’une exception légale. Comme on pouvait le craindre, ce transfert de compétence a conduit à une augmentation de la population carcérale, même si, dans son principe, la réforme visait aussi à lutter contre l’inflation carcérale. Le régime antérieur créait en effet une illusion de non-exécution des peines, incitant certains magistrats à prononcer des peines plus longues.
Pourquoi avoir décidé d’y consacrer un ouvrage ?
Il s’agit d’une réforme majeure, aux enjeux fondamentaux, dans un contexte où les effets délétères de l’inflation carcérale font régulièrement la Une de l’actualité et où l’exécution des peines privatives de liberté est souvent dénoncée pour son opacité. L’équipe de recherche a voulu analyser son impact concret, à la fois au moment du prononcé de la peine et lors de son exécution. Cette étude a été présentée lors d’un colloque en novembre 2024, et le livre compile les résultats de cette recherche avec des données inédites et les retours de praticiens. Dans un environnement où les politiques pénales sont souvent réactives et improvisées, cet ouvrage vise à alimenter la réflexion sur l’avenir de l'exécution des peines, soulignant la nécessité d’une préparation minutieuse et d’une évaluation scientifique approfondie.
Quels sont les grands constats qui ressortent de la recherche menée par votre équipe et présentée dans l’ouvrage ?
L’étude présente deux volets : l'un sur les juges du fond (qui prononcent les peines) et l'autre sur les JAP (qui les aménagent). Les deux groupes de magistrats partagent des constats similaires, notamment sur les limites du système actuel d’exécution des peines.
Les juges du fond rencontrent une difficulté à prendre en compte l'exécution des peines dans leur décision. Leur manque de formation spécifique sur le droit de l'exécution des peines et la complexité du cadre juridique les rendent souvent hésitants. Ils estiment que la prison est nécessaire en dernier recours, après l'échec des autres peines, tout en étant conscients de ses limites, notamment en raison de la surpopulation carcérale.
Concernant les JAP, l’étude souligne la précarité des justiciables, leur faible information et la lenteur administrative dans le traitement des dossiers. La mise en œuvre de la peine est également entravée par la mauvaise circulation des informations entre les acteurs judiciaires et pénitentiaires. De plus, la recherche a révélé des tensions liées à l’application des congés pénitentiaires prolongés, notamment en raison de leur absence de base légale. Les JAP expriment une volonté de ne pas être de simples "presse-boutons" et insistent sur la nécessité d’une évaluation individualisée des situations des justiciables. Toutefois, cette exigence d’informations complètes engendre une surcharge de travail et un allongement du traitement des dossiers. La coexistence de plusieurs instances décisionnelles, comme les commissions de probation et les JAP, génère aussi des contradictions.
Globalement, l'étude montre l’écart entre les objectifs de la réforme et sa mise en œuvre concrète, appelant à une meilleure formation des magistrats, une meilleure circulation des informations et un soutien sociojuridique plus solide pour les justiciables. Un dialogue renforcé entre juges du fond et JAP est aussi nécessaire pour améliorer l’efficacité de l’exécution des peines.
Que pensez-vous de la loi du 18 juillet 2025 portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons qui vient une nouvelle fois réformer la matière ?
La loi adoptée le 18 juillet 2025 et entrée en vigueur le 4 août 2025, modifiant à nouveau l'exécution des peines, a radicalement transformé la fonction du juge de l’application des peines. Initialement, le projet de loi prévoyait un retour à une compétence de l’administration pénitentiaire, mais l’avis du Conseil d’État a conduit au maintien du rôle du JAP. Toutefois, cette réforme réduit considérablement le rôle décisionnel de ce dernier, qui se voit désormais cantonné à une fonction plus administrative, ressemblant à celle de "presse-bouton". Les audiences sont supprimées et les possibilités de demander des informations complémentaires sont fortement limitées. Ce changement va à l’encontre des résultats de notre étude, qui montre que les JAP souhaitent une responsabilité plus grande dans l’examen des situations individuelles.
La loi du 18 juillet 2025 s'inscrit dans une tendance à réformer dans l’urgence, sans offrir de solutions structurelles à long terme. Dans ce contexte, on peut se demander s’il ne serait pas préférable, plutôt que de maintenir une illusion de judiciarisation, d’explorer la piste de mécanismes de libération plus automatiques pour les peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans. Une telle évolution permettrait de recentrer l’intervention du juge de l’application des peines sur les dossiers présentant une complexité particulière, où un réel pouvoir d’appréciation est requis, tout en lui confiant une mission de suivi dans les autres cas. Enfin, l’étude souligne la nécessité de fonder les réformes sur des recherches empiriques et des évaluations rigoureuses.