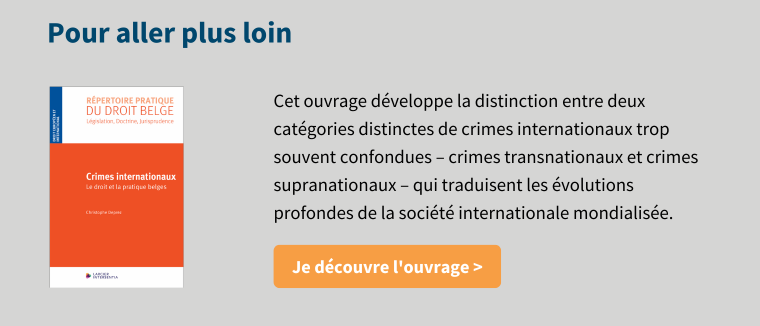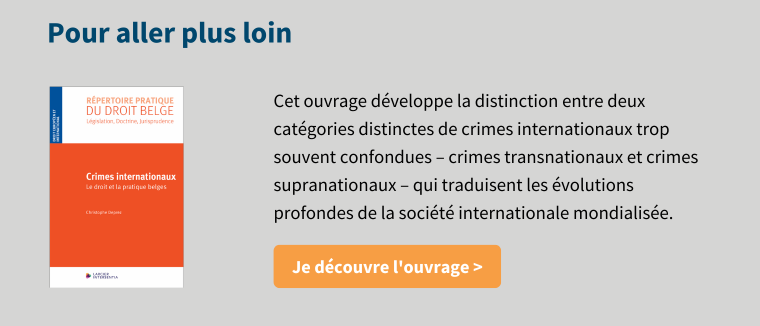Journée de la Justice pénale internationale
Entretien avec Christophe Deprez


À l’occasion de la Journée de la Justice pénale internationale, nous avons rencontré Christophe Deprez, auteur d’un récent ouvrage portant sur l’expérience belge en matière de crimes internationaux. Nous l’avons interrogé sur sa vision de la justice pénale internationale, à l’heure où les conflits et les violations du droit international humanitaire et des droits humains se multiplient.
Pourquoi une « Journée de la justice pénale internationale » ?
La célébration d’une Journée de la justice pénale internationale a été proposée en 2010 par l’Assemblée des États Parties au Statut de la Cour pénale internationale, un forum qui réunit annuellement l’ensemble des (actuellement 125) États membres de la Cour. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’importance de soutenir les victimes et les acteurs compétents pour lutter contre les crimes internationaux, c’est-à-dire les crimes de guerre, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes d’agression. Le 17 juillet a été choisi car c’est à cette date que fut adopté le Statut de la Cour pénale internationale, en 1998, à Rome.
Vingt-sept années plus tard, quel est le bilan de la CPI ?
La création de la Cour a fait naître d’immenses espoirs pour la lutte contre les crimes internationaux. Or, il est aujourd’hui clair que les capacités d’action de la Cour sont limitées. À ce jour, seule une dizaine d’affaires ont été menées à leur terme. Plusieurs dizaines d’autres dossiers sont certes en cours, comme les situations en Ukraine et en Palestine par exemple, mais tous les États ne soutiennent pas ces enquêtes, et certains s’appliquent même à détricoter activement son action. Plusieurs représentants de la Cour font ainsi l’objet de sanctions présidentielles américaines, pour avoir émis un mandat d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à l’encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu notamment.
La justice pénale internationale est donc paralysée par la realpolitik ?
Il est clair que la justice pénale internationale relève du droit international et que celui-ci est ce que les États décident d’en faire. D’un autre côté, les pressions sur la Cour ne datent pas d’hier, et on constate qu’elles n’ont, précisément, pas empêché – pour nous en tenir au même exemple – l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Netanyahu. Certains y verront le témoin de l’indépendance de la Cour et du fait que la justice pénale internationale ne constitue pas ou plus un outil aux seules mains des vainqueurs ou des puissants. D’autres observeront de façon plus critique que plusieurs États ont, depuis lors, refusé d’arrêter M. Netanyahou – en particulier la Hongrie, qui a entretemps annoncé qu’elle quitterait le Statut de Rome.
Face à l’immensité de la tâche, la CPI est-elle la seule instance compétence ?
Pas du tout – vous avez raison de le souligner. On tend souvent à apprécier l’efficacité de la justice pénale internationale à l’aune de l’action de la seule CPI. C’est une erreur car, au premier chef, c’est aux États qu’il revient de poursuivre et de juger les crimes internationaux. L’existence de la Cour pénale internationale vise seulement à stimuler ces efforts nationaux et à assurer un filet de sécurité. À l’instar de la Belgique, de nombreux États dotent ainsi leurs tribunaux nationaux de compétences extraterritoriales (pouvant aller jusqu’à une forme de compétence universelle) pour juger certains crimes graves commis à l’étranger. Pour en revenir à Gaza, la Cour pénale internationale n’est donc pas la seule à enquêter : plusieurs dizaines d’affaires ont déjà été introduites devant des juridictions nationales, y compris en Belgique.
Dans les faits, les violations du droit international continuent de se succéder. Cela signifie-t-il que la justice pénale internationale est inefficace ?
Cela dépend des objectifs qu’on lui fixe. Il est clair que les violations des droits humains et du droit humanitaire sont légion, à tel point qu’on tend parfois à se demander si l’idée même d’une justice internationale a encore un sens. D’un autre côté, la justice est, par définition, une entreprise réactive : elle vise à apporter certaines réponses, nécessairement tardives et insuffisantes, à des crimes déjà commis. Ceci fait écho aux questionnements liés à la raison d’être du droit international. La violation de ce dernier peut, au fond, donner lieu à deux types de réactions bien différents – consistant soit à conclure à son inutilité, soit à constater la nécessité de redoubler d’efforts pour le promouvoir. L’idée d’une « Journée de la justice pénale internationale » relève assurément de cette seconde approche.