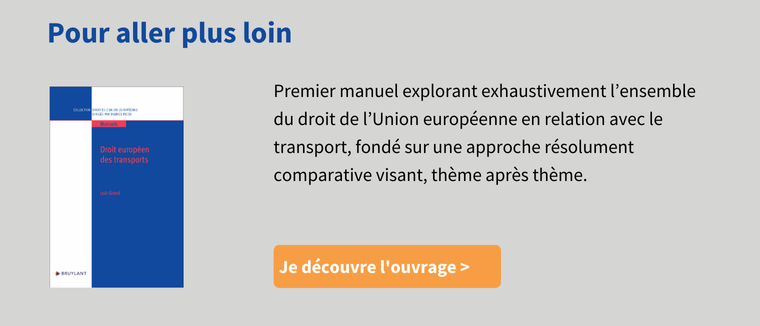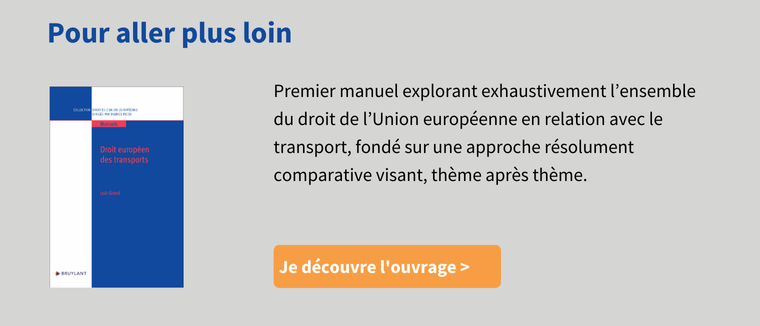Droit européen des transports
Entretien avec Loïc Grard


L’ouvrage « Droit européen des transports » est le premier manuel explorant exhaustivement l’ensemble du droit de l’Union européenne en relation avec le transport. Fondé sur une approche résolument comparative, il vise, thème après thème, à présenter les problématiques communes aux différents modes de déplacements des personnes et des marchandises : aérien, maritime, ferroviaire fluvial et routier. Nous avons rencontré son auteur.
Vous êtes l’auteur du récent manuel « Droit européen des transports » édité dans la Collection de droit de l’Union européenne sous la marque européenne Bruylant. Il s’agit d’une somme dans une jungle de textes législatifs épars encore inexplorée. Toutes nos félicitions pour ce véritable apport doctrinal ! L’ouvrage couvre-t-il tous les transports : l’aérien, le maritime, le fluvial, le ferroviaire et le routier ?
Oui les transports sont envisagés dans leur ensemble : mobilité des personnes et des marchandises par voies terrestres, maritime et aérienne. Aucun mode n’échappe aujourd’hui à l’emprise du droit de l’Union européenne. À des rythmes différents chacun s’est juridiquement européanisé. Sur un grand nombre de sujets, l’aérien a montré le chemin. Tel est notamment le cas en ce qui concerne l’affirmation des droits de voyageurs ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Pour chaque mode, l’ouvrage met en évidence la force réformatrice de la législation européenne. La question du service public est à cet égard tout à fait révélatrice. L’Union a imposé un modèle nouveau de commande publique de mobilité des personnes réduisant les fractures territoriale et favorisant l’inclusion.
Dans votre rédaction, quel a été votre fil conducteur/votre démarche vous permettant de créer un cadre à même de fédérer les questions qui agissent en commun dénominateur de tous les modes de transports ?
Le manuel repose sur une grille de lecture commune du droit appliqué à chacun des modes de transport. Outre la prestation de transport proprement dite, il aborde l’ensemble des facteurs rendant ce dernier possible autant que des externalités avec lesquelles il doit composer. Il prend pour hypothèse que les traités fondateurs de l’Union autant que la législation agissent dans une perspective ordolibérale. Dès lors, oui, le point de départ se situe dans la formation du marché unique au sein duquel les transporteurs se font librement concurrence. Mais le point d’aboutissement est autre. La législation européenne harmonise par le haut les conditions d’exploitation du marché, que ce soit en matière de sécurité, de marché de l’emploi ou encore dans le sens de l’amélioration des infrastructures toujours plus fiables, plus accessibles et toujours mieux connectées entre elles.
Nous constatons que la matière du droit européen des transports fait l’objet de plus en plus de jurisprudence. Comment l’expliquer ? L’accroissement des transports aériens, le développement de la mobilité des travailleurs… ? Quels sont les principaux acteurs impactés par cette jurisprudence ?
Pas moins de 300 arrêts de la Cour de Justice de l’Union sont répertoriés. Dans cet ensemble, quelques-uns se détachent au-delà des jurisprudences fondatrices de la matière telle « Nouvelles Frontières » en 1986 qui marqué le point de départ de l’ouverture du ciel européen à la concurrence. Ainsi l’arrêt « Sturgeon » en 1989 consacre un véritable statut pour le passager aérien. Plus récemment le 4 octobre 2024, la Cour de Justice procède à un rappel à l’ordre quant aux dynamiques de la concurrence en matière de transport routier en insistant sur le nécessaire accroissement de la protection sociale des travailleurs mobiles.
Quel est le rapport entre le droit européen des transports et le droit européen de la concurrence ? La libéralisation connait-elles des limites en matière de transports en Europe ? Et dans le monde ?
Le droit européen de la concurrence a été créateur et aujourd’hui réparateur du marché des transports. Créateur parce que c’est par son entremise que s’est mis en route la législation européenne propre au transport. Réparateur car aujourd’hui ses principes agissent avec constance pour contenir toute tentation de fausser les lois du marché. C’est ainsi que le droit des aides d’État a permis à la Commission européenne autant qu’aux juges de clarifier les conditions dans lesquelles les transporteurs sont mis en concurrence comme le montre la manière par laquelle la desserte maritime corse a été régulée. Au plan mondial, il faut admettre, même si le terme fait débat, l’éclosion d’une véritable souveraineté européenne assurant la défense des transporteurs européens et préservant leur compétitivité.
Vous avez rempli une page blanche en vous investissant dans la rédaction du premier manuel de droit européen des transports. Quelle sera votre prochaine page à remplir au-delà de la mise à jour de votre manuel ?
Le manuel de droit européen des transports n’aurait pas vu le jour sans les années de travail qui l’ont précédé et le nombre important de publications scientifiques corrélatives. C’est un peu le résultat d’une vie de chercheur. Tout a commencé il y a plus de trente ans avec ma thèse sur le marché unique du transport aérien. Petit à petit, je me suis ouvert à l’étude de l’ensemble des autres modes de transport. Mais pour boucler la boucle, à présent un seul projet n’est envisageable : revenir au point de départ pour rédiger un manuel de droit aérien, matière que j’enseigne à Bordeaux en Master depuis 1992…